p. 66
Je fus reçu aux Beaux-Arts de Lyon avec un maigre dossier qui comprenait des copies de quelques Picasso de la période cubiste faciles à imiter.
 |
| Femme à l'éventail de Picasso |
On me dit que j’avais des dispositions pour la peinture, mais ce qui était enseigné ne me convenait pas. Je voulais apprendre à dessiner et peindre selon les critères classiques. Seul le cours de dessin de Monsieur René Chancrin m’intéressait. Peintre de natures mortes, Chardin local et gloire lyonnaise, il savait comme personne rendre le poudreux de la farine et la brillance des œufs. Nous travaillions d’après des chapiteaux et des antiques. Il m’avait dit : « Apprends d’abord à dessiner et ensuite nous verrons si tu as quelque chose à dire. »
 |
De René Chancrin :
Amandes et pastèques
Pain et vin |
Ce quelque chose à dire me rendait anxieux. Et si je n’avais rien à dire ? Mon ambition se cantonnait à devenir professeur de dessin pour travailler moins et avoir du temps pour vivre. Comme je portais une blouse grise et un béret et que je rangeais mes tubes de peinture dans une boîte à outils en métal bleu, pour les anciens, j’étais « le mec de chez Renault. » Ils me raillaient et le bizutage fut cuisant. Je fus trempé nu dans une baignoire remplie de peinture bleue, on me cassa des œufs sur la tête, et je fus nettoyé à grands coups de balai brosse. Les anciens me promenèrent dans les rues avec, attachées à la taille, quelques boîtes de conserve vides au bout d’une ficelle. Mes premiers pas en art furent difficiles. Je dus mon salut à la sympathie que j’inspirais à deux anciennes qui me prirent sous leur protection pour écourter mon calvaire.
|
|
On aperçoit au premier plan, le rebord de la baignoire
|
p. 66 et 67 À l’École, l’ambiance était encore celle des artistes maudits. Soirées nouilles et vin, discussions enfiévrées, hiver sans chauffage. Certains garçons portaient encore le costume de velours marron, la barbe, et fumaient la pipe bourrée d’Amsterdamer. Les deux anciennes buvaient sec et il fallait parfois les retenir en haut des escaliers pour éviter qu’elle ne se jettent dans le vide en criant le nom de leurs amants. Ces derniers ne comprenaient pas pourquoi elles couchaient avec d’autres dans nos soirées en criant : « Ne me laisse pas avec lui mon amour, viens je t’en prie, viens te joindre à nous. » Époque bénie que je perpétuai l’année suivante en étant reçu aux Beaux-Arts de Paris.
 |
Nous avions parodié le Déjeuner sur l'herbe de Manet en le renommant
Le déjeuner sur la paille. |
Aux Beaux-Arts de Paris les femmes qui posaient étaient pudiques. Elles se déshabillaient derrière un paravent et venaient poser sur la sellette, parfois avec leur chien, sage comme une image de chien. Elles déposaient un gros réveil à côté de leurs mules aux couleurs vives pour les 45 minutes réglementaires et les rechaussaient pendant le quart d’heure de repos, drapées dans un peignoir élimé. Elles portaient la nudité comme d’autres arborent l’uniforme : avec prestance et fierté. L’une était américaine et l’autre russe. Elles se prénommaient Carol et Dimitrova. Carol avait des jambes interminables et fut mannequin aux États-Unis. Le corps trapu et ferme de Dimitrova, d’origine bulgare plaisait aux sculpteurs. À la pose elles venaient jeter un coup d’œil sur les croquis pour les commenter. Elles n’en profitaient pas pour étirer leur temps de repos. Le quart d’heure passé, Carol, s’écriait invariablement : « Allez, au travail ! »
Dimitrova respectait une immobilité parfaite pendant le temps de pose. Seuls quelques mouvements de sourcils et la ligne de sa bouche sursautaient après plusieurs heures stoïques. Carol avec son regard hautain et la fierté d’être une muse ne laissait rien entrevoir des difficultés à tenir la pose.

p. 69 Un an après le début de mes études aux Beaux-Arts, je me suis présenté au poste d’assistant de monsieur Tondu. Je l’aidais à organiser les séances quotidiennes de travail avec les modèles vivants. Nous étions très peu nombreux à fréquenter son atelier remisé au dernier étage de l’Hôtel de Chimay dont les fenêtres donnaient sur la Seine et le musée du Louvre. Le vieux professeur sortait toujours la même blague : «On peut dire qu’il y a dans mon atelier trois pelés et un Tondu. »
La révolution culturelle de mai 68 était passée par là. Toutes les copies des antiques avaient été déménagées pour laisser le Palais des Études totalement vide.
 |
A gauche une vue partielle du Palais des Etudes avant le déménagement des copies d'antiques. De nombreux étudiants venaient étudier et se confronter au dur apprentissage du dessin et du lavis. A droite, le même lieu, renommé Cour vitrée. Un immense hall, une salle des pas perdus désaffectée. |
La particularité de l’atelier Tondu fut de conserver l’enseignement du portrait et de la figure peinte d’après modèle vivant. Il avait été l’élève de Cormon, un artiste de la Belle Époque qui peignait de grandes scènes de la préhistoire. Cormon initia des élèves tels que Matisse, Toulouse-Lautrec, Soutine et même van Gogh. Monsieur Tondu se vantait d’avoir dépanné Soutine en lui prêtant un tube de rouge de cadmium qui aurait servi à peindre son Bœuf écorché . Il avait obtenu le Prix de Rome en 1931. Sa toile représentait une famille française qui avançait de front. L’un d’eux portait un gros pain sous le bras. Sa mémoire immédiate lui faisait défaut, et il ressassait toujours les mêmes anecdotes de sa jeunesse. Atteint de surdité, il évitait de poser des questions de peur de ne pas comprendre les réponses. Il ne jurait plus que par Ingres et La Femme à la perle de Camille Corot. Il admirait la matière fatiguée du visage. Elle témoignait selon lui de la lutte du peintre avec son exigence. On connaît moins les portraits de Corot que ses paysages. Pourtant dans ses portraits, la subtilité des coloris évoque plus sûrement la présence de la terre et la couleur des plantes.

La femme à la perle de Camille Corot
 |
J'avais demandé à cette femme qui fréquentait un bistrot de la rue Jacob de venir poser pour moi à l'atelier.
Pendant les deux premières années aux Beaux-Arts, je me suis consacré presque exclusivement au dessin et à la peinture mais la photographie m'attirait. J'avais pour projet d'aller photographier les modèles professionnels dans leur lieu de vie. Certaines étaient proches de la retraite et je voulais savoir dans quelles conditions elles vivaient. Madame Stéfanopoli avait une allure de grande bourgeoise mais les dernières années, atteinte par le maladie elle vivait dans une chambre minuscule et le désordre était à son comble. Elle accepta que je la photographie mais à peine avions nous commencé que sa fille que je ne connaissais pas frappa à la porte. Elle me dit de ne pas parler de séance photo, mais elle finit par lui dire pourquoi j'étais là. Elle l'invita à poser auprès d'elle. Sa fille y consentit à condition de garder son pantalon car elle avait ses règles.Ce que madame Stéfanopoli voulait mettre en scène, c'était son ascendant sur sa fille qu'elle considérait peu cultivée et sans classe.

J'ai aussi photographié Solange, un modèle qui "prenait bien la lumière" et dont les formes se
déployaient harmonieusement quand elle s'allongeait. Malheureusement dans mon entourage,
mes premières séances furent malvenues et j'arrêtai de photographier pendant près de quatorze ans.
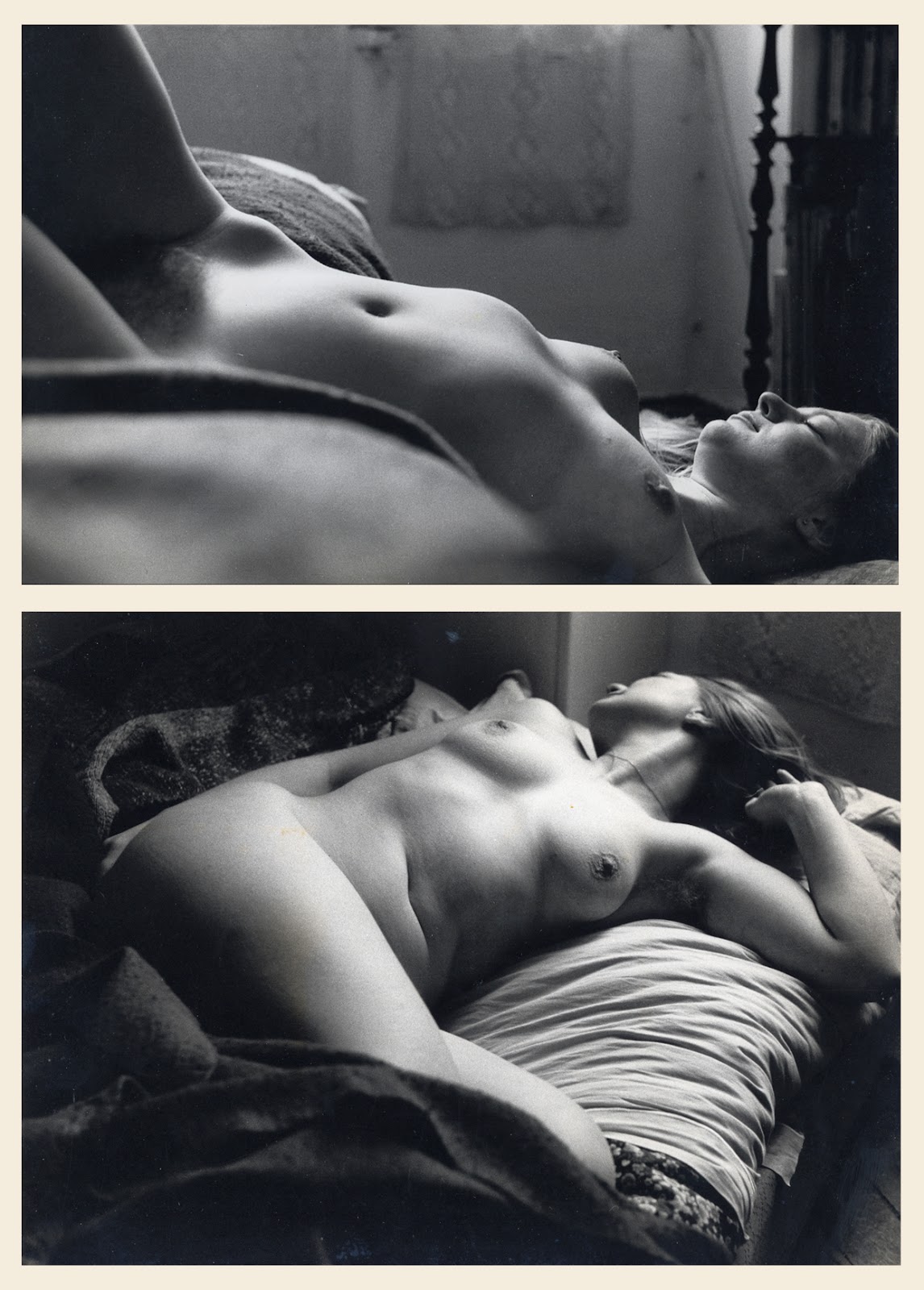
p. 78 et 79 Pendant toutes ces années, je me suis englué en peinture. J’aimais pourtant la contempler, et après chaque visite de musée, renaissait en moi l’envie de peindre. Mon ascèse temporaire ne tardait pas à être balayée par les difficultés rencontrées. Je mesurais l’écart considérable qui me séparait des chefs-d’œuvre. La nature même de la peinture à l’huile m’entraînait dans une confusion des couleurs, qui en se mélangeant, produisaient un gris sale et une certaine veulerie de la forme. Je devais donc attendre patiemment le séchage pour continuer à monter la couleur. Parfois la dimension du support et les formes inscrites ne s’entendaient pas entre elles. À d’autres moments les pinceaux n’avaient pas la bonne taille, la toile trop lisse ou trop rêche n’était pas en adéquation avec le sujet. Il m’arrivait de quitter l’atelier avec la vision d’une peinture lumineuse. Mais pendant la nuit, les couleurs fraîches se mélangeaient, et le lendemain matin le résultat me paraissait terne. Tout était à reprendre.
J’aurais pu faire de la peinture comme on aime cuisiner. M’en barbouiller des pieds à la tête et sortir en fin de journée, la salopette et les mains maculées comme une palette pour aller boire une bière sur le zinc du café du coin. Mais mon travail ne se démarquait pas de ce qui avait déjà été fait. J’avais réussi à peindre une poignée d’œuvres qui me semblaient honorables. J’ai tenté d’élargir la palette des peintures océaniennes de la terre d’Arnhem au nord de l’Australie où la monnaie locale était basée sur l’échange de pigments.
Deux versions des Trois Parques
A gauche, Namarwon Dieu de la foudre, peint sur écorce en Terre d'Arnhem
A droite, une interprétation plus colorée peinte en 1990 à Paris
Je savais à peine lire quand je voulais me procurer le magazine "Spirou" chez le libraire, la veille de la parution hebdomadaire. J'espérais en vain que le précieux magazine serait déjà livré. Le marsupilami a quelque ressemblance avec Namarwon. Alors que les attributs sexuels sont généreusement décrits pour Namarwon, ils apparaissent de façon subliminale dans le déplacement nuageux du marsupilami.
Lointain Rwanda 1994
p. 78 Une fois de plus, l’École a dernièrement pris en marche le wagon de queue de la modernité en nommant comme nouveau directeur l’ancien responsable du Palais de Tokyo. Les parcs d’attraction et les lieux d’exposition peuvent se donner la main dans une ronde où les Mickey, les Astérix, les chiens de porcelaine de Jeff Koons s’entraînent dans une folle farandole ludique et festive. Le jeu consiste maintenant à savoir faire la différence entre certaines œuvres exposées et les objets mis en scène fortuitement par les travaux en cours. Concevoir devient plus important que réaliser, et il est préférable pour un artiste d’avoir un carnet d’adresse de bons artisans plutôt que de se décevoir dans la confrontation avec la résistance des matériaux. Si le spectateur n’a pas de sens ludique, et s’il ne fait pas appel à son intellect pour tirer de l’œuvre la satisfaction de sa propre intelligence, il passe devant, incrédule, poussette à la main pour initier très tôt sa progéniture aux mystères de la création.

|









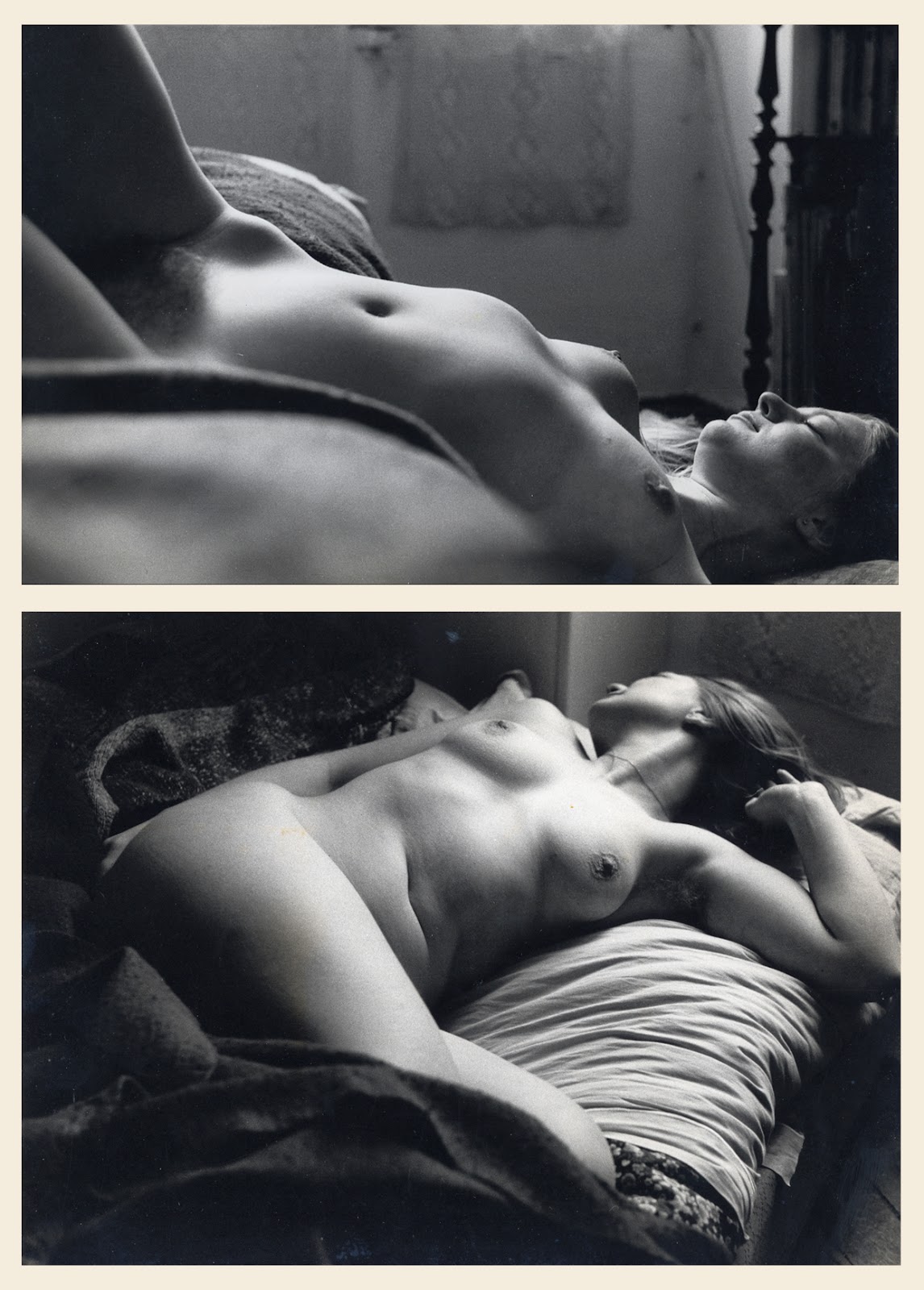





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire